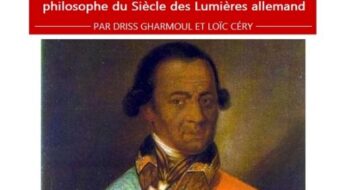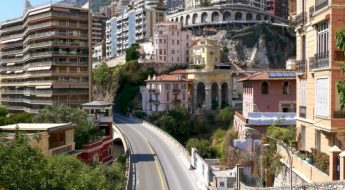Le tombeau de Napoléon est situé dans la crypte centrale de l’Eglise du Dôme Eglise à l’Hôtel des Invalides à Paris, France. Les restes de l’empereur, à l’intérieur du sarcophage, sont protégées par les six cercueils concentriques, construits à partir de différents matériaux, y compris l’acajou, l’ébène, et le chêne
I. L’Écrin de Solennité : L’Église du Dôme
Avant d’atteindre le cœur de la crypte, il faut lever les yeux. Nous pénétrons d’abord dans l’Église du Dôme, achevée en 1706 sous le règne de Louis XIV. Ce n’est pas une simple chapelle, mais un joyau de l’architecture classique française, souvent attribué à Jules Hardouin-Mansart.

Le dôme doré des Invalides crée sous Louis XIV par Hardouin-Mansart et aujourd’hui résidence du repos éternel de l’Empereur Napoléon 1er.📷 laurent_a_paris
L’Apogée du Baroque et la Lumière Divine
L’Église du Dôme, avec sa structure en croix grecque, est l’exemple même de la grandeur baroque voulue par le Roi-Soleil. Sa coupole, visible de tout Paris, est un exploit technique et esthétique. Initialement dorée en 1715, sa réverbération est conçue non seulement pour éblouir, mais pour symboliser la gloire éternelle du monarque – une gloire que Napoléon, indirectement, se réappropriera.
L’intérieur de la coupole est un spectacle de fresques vibrantes. Le plafond, réalisé par Charles de La Fosse, dépeint notamment Saint Louis remettant l’épée à Jésus-Christ. L’effet est spirituel et politique : il ancre la monarchie française dans une légitimité divine. Lorsque l’on se tient sous cette voûte céleste, on comprend que l’Empereur n’est pas enterré dans une église ordinaire, mais dans un véritable temple civique et religieux.
Le Dôme, à l’origine conçu pour abriter les restes des Bourbons, est devenu, par un renversement historique d’une ironie spectaculaire, la nécropole des Bonaparte et des gloires militaires de la Nation.
II. De Sainte-Hélène à Paris : L’Épopée du Retour des Cendres
Pour mesurer l’ampleur du tombeau, il est essentiel de se souvenir d’où l’Empereur est revenu.
L’Exil et la Mort (1815-1821)
Le 5 mai 1821, après six années d’exil forcé sur l’île volcanique et isolée de Sainte-Hélène, Napoléon Iᵉʳ s’éteint. Il fut enterré dans un lieu modeste, la Vallée du Géraniums, sous une simple dalle de pierre non marquée (craignant que ses ennemis ne profanent sa sépulture). Ses restes y reposèrent dans un silence amer jusqu’en 1840.
Durant ces années, le mythe napoléonien grandit en France, dépassant les clivages politiques. L’image de l’Empereur, victime des Anglais, devient un puissant symbole nationaliste.
Le Coup de Théâtre de 1840
Dix-neuf ans après sa mort, sous le règne de Louis-Philippe, le désir de rapatrier les restes de l’Empereur devint une nécessité politique. Louis-Philippe, cherchant à consolider sa légitimité auprès du peuple français, chargea son fils, le Prince de Joinville, d’une mission extraordinaire : ramener l’Aigle sur le sol français.
Ce fut le fameux « Retour des Cendres. »
L’exhumation, menée le 15 octobre 1840 à Sainte-Hélène, fut un moment d’une solennité macabre. Le corps, remarquablement conservé, fut placé dans un nouveau cercueil avant d’être transporté sur la frégate La Belle Poule. Le voyage fut une véritable épopée maritime.
À l’arrivée en France, le 15 décembre 1840, les funérailles d’État furent l’événement public le plus grandiose du XIXᵉ siècle. Des centaines de milliers de Français bravèrent le froid glacial pour assister au passage du convoi funèbre sur les Champs-Élysées, avant que la dépouille ne rejoigne le port temporaire à la Chapelle Saint-Jérôme, en attendant l’achèvement de sa dernière demeure.
Pour la première fois depuis 1815, le mythe et la réalité du corps impérial se rejoignaient. Mais il fallait un lieu à la hauteur de cette histoire.

III. Le Sarcophage de Porphyre : L’Œuvre de Visconti
L’incroyable défi de concevoir le tombeau revint à l’architecte Louis Visconti en 1842. Il ne s’agissait pas de créer une simple tombe, mais un environnement architectural complet capable d’accueillir la légende.
Le Redimensionnement de la Crypte
Visconti dut repenser l’intérieur de l’Église du Dôme. Il abaissa le niveau de la crypte centrale, créant une fosse circulaire profonde et ouverte. Cette disposition est essentielle : le visiteur, depuis la balustrade supérieure, doit se pencher et regarder vers le bas pour contempler le sarcophage. Ce geste d’inclinaison forcée est une marque de révérence, un hommage physique à un homme qui domina l’Europe.
Le tombeau fut finalement achevé et inauguré en 1861 sous Napoléon III, le neveu de l’Empereur.
Le Choix du Porphyre Rouge
Au centre de cette crypte spectaculaire trône le sarcophage. Il est conçu dans un matériau d’une importance capitale : le porphyre rouge.
Le porphyre n’est pas un choix anodin. C’était la pierre réservée aux empereurs romains de l’Antiquité. En choisissant ce matériau rare et difficile à travailler (importé de Carélie, en Russie, un cadeau du Tsar Nicolas Iᵉʳ), Visconti et l’État français associaient symboliquement Napoléon à la lignée des plus grands souverains de l’histoire. Sa couleur rouge sombre, presque violacée, confère à la sépulture une gravité impériale éternelle.
Le sarcophage repose sur un socle de granit vert des Vosges, contrastant magnifiquement avec le chaud porphyre rouge.
Le Décor Symbolique
Autour du tombeau, Visconti a déployé un programme iconographique riche :
- Les Douze Victoires : Une galerie ronde entoure la crypte, bordée de douze statues colossales, des allégories féminines représentant les grandes victoires militaires de l’Empire. Sculptées par Jean-Jacques Pradier, ces figures musculeuses et drapées incarnent la puissance et l’étendue de l’hégémonie napoléonienne.
- Les Bas-Reliefs de Simart : Sous la coupole intérieure du caveau se trouve une série de bas-reliefs de Pierre-Charles Simart. Ces œuvres illustrent les grandes actions civiles de Napoléon, rappelant que son héritage va au-delà des batailles : le Conseil d’État, le Code Civil, le Concordat, l’Université. Ces inscriptions sont des rappels que l’Empire fut aussi une œuvre législative et administrative colossale.
- La Statue de l’Empereur : Au fond de la crypte, juste derrière l’autel redessiné par Visconti pour s’harmoniser avec la tombe, se dresse une statue de Napoléon, revêtu de ses emblèmes impériaux, coiffé du laurier et tenant le sceptre. Elle est l’image du souverain éternel.

Statue de l’Empereur Napoléon dans la cour des Invalides.
L’atmosphère est rendue quasi mystique par la lumière qui descend de la coupole dorée et se réfléchit sur les marbres colorés.

Le cercueil de Napoléon 1er, Empereur des Français , sous les voûtes du dôme doré des Invalides, un tombeau insolite.
IV. Le Secret des Six Cercueils Concentriques
Lorsque l’on évoque le tombeau de Napoléon, on ne parle pas d’une simple boîte, mais d’une véritable matriochka funéraire conçue pour la protection et l’immortalité. Pour Napoléon Iᵉʳ, le passage entre le statut de simple mortel et celui d’icône historique nécessitait une préparation exceptionnelle.
Les restes de l’Empereur sont logés non pas dans un, mais dans six cercueils concentriques (certains sources en évoquent même sept, selon la manière dont on compte la coquille de plomb intermédiaire), chacun construit dans un matériau différent, symbolisant une couche supplémentaire de sécurité et de vénération.
Ce dispositif impressionnant nous révèle la préoccupation de l’époque d’assurer l’éternité du corps :
- Le premier cercueil : En fer-blanc (ou fer blanc étamé), une enveloppe simple.
- Le deuxième cercueil : En acajou, l’essence que l’on trouve souvent à Sainte-Hélène.
- Le troisième cercueil : En plomb, assurant l’étanchéité et la protection des restes.
- Le quatrième cercueil : En chêne de Saint-Domingue, bois symbolisant la force et la noblesse militaire.
- Le cinquième cercueil : En ébène, bois précieux et sombre, souvent utilisé pour les reliques.
- Le sixième cercueil : En chêne, enveloppe extérieure finale, insérée dans le grand sarcophage de porphyre.
Cette superposition, détaillée dans les archives des Invalides, est un témoignage fascinant des rituels funéraires du XIXᵉ siècle, tout en soulignant la valeur quasi sacrée attribuée au corps de l’Empereur.

Le Pont Alexandre III au crépuscule avec les Invalides , là où, repose le tombeau de Napoléon dans le fond.
V. Le Panthéon Militaire : Les Autres Gloires du Dôme
L’Église du Dôme n’est pas uniquement le mausolée de Napoléon. Elle est le panthéon des figures militaires qui ont forgé la France, qu’elles soient de l’Empire ou de la République. La présence de ces autres sépultures confère à la crypte un rôle de sanctuaire national.
La Famille Bonaparte

Le roi Jérôme, tombeau du frère de Napoléon aux Invalides à Paris.
Autour, mais dans des cryptes moins profondes ou latérales, reposent plusieurs membres de la famille impériale :
- Jérôme Bonaparte : Le plus jeune frère de Napoléon, qui fut Roi de Westphalie. Ses restes ont été ramenés d’Allemagne.
- Joseph Bonaparte : Frère aîné de Napoléon, Roi de Naples puis d’Espagne.
- Napoléon François Joseph Charles Bonaparte, dit l’Aiglon : Le fils unique et héritier de Napoléon Iᵉʳ et de Marie-Louise, Duc de Reichstadt, décédé à Vienne en 1832. Son rapatriement fut un geste politique fort d’Adolf Hitler en 1940, mais ses restes ont été mis dans la crypte des Invalides, ajoutant une note tragique et romantique à l’ensemble.
Les Héros du XXe Siècle
Dans des temps plus récents, l’Hôtel des Invalides a continué d’accueillir les sépulcres des grands chefs militaires français qui ont marqué les guerres mondiales, symbolisant la continuité de l’honneur des armes :
- Maréchal Foch : Commandant en chef des armées alliées sur le front occidental durant la Première Guerre mondiale. Sa tombe est particulièrement sobre et émouvante.
- Maréchal Lyautey : Figure majeure de la colonisation française et Académicien.
En visitant les Invalides, on ne se recueille pas seulement devant Napoléon. On traverse un siècle et demi d’héroïsme militaire français, le tombeau de porphyre servant de point focal à cette immense mémoire collective.
Conclusion-
Quitter la crypte de Napoléon est toujours un moment de silence. L’atmosphère est lourde, non pas de tristesse, mais du poids d’une ambition démesurée et des millions de vies qui ont balisé son parcours.
On a beau connaître les dates, les batailles, les lois, l’émotion qui saisit le visiteur devant ce sarcophage pourpre est unique. Il y a une violence contenue dans le porphyre, une éternité obstinée qui défie le temps et les critiques.
L’architecture de Visconti a réussi son pari : en descendant dans cette fosse circulaire, nous ne regardons pas un homme à terre, mais un titan dont la gloire s’est cristallisée dans la pierre. Le contraste entre le modeste sépulcre de Sainte-Hélène et cette apothéose parisienne est le plus puissant des rappels historiques : l’Empereur a perdu la guerre, il a perdu son trône, mais il a gagné le combat de l’immortalité.
Le Dôme, autrefois consacré à la gloire de Louis XIV, est devenu l’écrin de l’homme qui a refondé la France moderne. C’est là, dans ce marbre froid, que réside l’énigme de Napoléon : un homme qui a cherché la lumière éternelle, et l’a trouvée, entouré des trophées de ses Victoires et sous la protection de six couches de bois et de métal. C’est l’art au service de la légende, la plus poignante des narrations funéraires. Une visite indispensable, une leçon d’histoire gravée dans le porphyre
Sources et Références.
Pour approfondir votre visite et la dimension historique du Tombeau de Napoléon :
Musée de l’Armée – L’Hôtel des Invalides (Site Officiel)
- Lien : https://www.musee-armee.fr/collections-et-departements/le-dome-des-invalides-tombeau-de-napoleon-ier.html
- (Détails sur l’architecture, l’histoire du lieu et la crypte.)
Fondation Napoléon – Le Retour des Cendres (Contexte Historique)
- Lien : https://www.napoleon.org/histoire-des-2-empires/articles/le-retour-des-cendres-de-napoleon-ier/
- (Informations détaillées sur le voyage de 1840 et les funérailles d’État.)
Ministère de la Culture (Architecture et Monuments Historiques)
- Lien : https://www.pop.culture.gouv.fr/notice/merimee/PA00088002
- (Notice détaillée sur l’architecture de l’Hôtel des Invalides, y compris l’Église du Dôme.)
Réunion des Musées Nationaux – Grand Palais (Œuvres de Visconti et Simart)
- Lien : https://www.grandpalais.fr/fr/article/le-tombeau-de-napoleon-ier-aux-invalides
- (Analyses sur la conception du monument par Louis-Tullius-Joachim Visconti.)
Copyright © 2019 Angie Paris Rues Méconnues Officiel. 1997-2019 Tous Droits Réservés
Sur le même sujet
L’Opéra Royal de Versailles : Un Joyau de l’Architecture et de la Culture