
Le temps file, les modes passent, mais certaines questions demeurent, intemporelles et fascinantes, lorsqu’il s’agit de décrypter les subtilités de notre vivre-ensemble. Parmi elles, l’influence du chapeau sur la politesse n’est pas la moindre. Plus qu’un simple accessoire de mode, le couvre-chef fut longtemps un véritable miroir des mœurs, un baromètre social, et un acteur silencieux des cérémonials de civilité. Plongeons ensemble dans cette histoire élégante et parfois espiègle qui lie le panache à l’art du salut, de l’Ancien Régime à nos jours.
L’Appel à l’Élégance : Quand le Chapeau Dictait les Manières
En 1923, au lendemain d’une Grande Guerre qui avait bousculé les codes et accéléré le rythme des changements sociaux, la revue « Monsieur : revue des élégances, des bonnes manières, et de tout ce qui intéresse Monsieur » était une sentinelle attentive du savoir-vivre. C’est dans ses colonnes que l’écrivain Paul Sentenac, fin observateur de son temps, lançait un vibrant plaidoyer en faveur du retour du haut-de-forme. Pour lui, ce couvre-chef emblématique de l’élégance d’antan était le véhicule idéal pour le rétablissement d’une politesse qu’il jugeait en déclin.
Sentenac ne s’y trompait pas : l’évolution des chapeaux, du majestueux tricorne du XVIIIe siècle au feutre mou ou au béret plus décontractés du début du XXe, s’accompagnait d’une transformation, voire d’une érosion des gestes de courtoisie. Le tricorne, en effet, avait été le fidèle allié des révérences profondes et du baisemain galant, sa forme même invitant à une manipulation aisée et gracieuse. Mais avec la disparition de ces ornements fastueux, Sentenac percevait une perte d’une certaine théâtralité sociale, d’une codification des interactions qui rendait la vie en société plus harmonieuse. Il voyait dans le haut-de-forme une promesse de retrouver cette grandeur perdue, d’un coup de chapeau qui, loin d’être anodin, serait une signature d’un respect et d’une prestance retrouvés.
Le Dandy et la Politesse : Le Débat sur le Geste du Salut
Le début du XXe siècle fut une période de transition où l’ancien et le nouveau se côtoyaient, non sans friction. Paul Sentenac rappelait à ce titre Marcel Boulenger, un romancier dont la plume acérée et l’esprit dandy étaient redoutables. Boulenger, également escrimeur et médaillé olympique, n’hésitait pas à fustiger, dans ses chroniques vivantes, ceux qui se montraient négligents en matière de politesse – notamment ceux qui omettaient de répondre aux lettres, ou pis encore, malmenaient le salut.
Marcel Boulenger mettait en scène un personnage qui, pour justifier son refus d’ôter son couvre-chef en saluant, s’exclamait : « Mieux vaut ne plus seulement porter un doigt à son chapeau depuis que l’on a renoncé au tricorne ; car le geste de soulever un feutre ou un melon est décidément trop laid. » Ce personnage, arguant de l’inélégance des gestes modernes, préférait l’omission totale à un salut jugé disgracieux.
Sentenac, avec une pointe d’ironie, soulignait que Boulenger plaçait ces paroles dans la bouche de son personnage pour mieux le vilipender ensuite. Car, pour Sentenac, ce personnage n’était qu’un rustre qui aggravait son cas en cherchant une mauvaise excuse à sa grossièreté. L’écrivain défendait l’idée que plus un mouvement de politesse est difficile à réaliser, plus le mérite de celui qui l’accomplit est grand, et plus sa politesse est éclatante.
Offrir sa place à une dame dans le métro devient ainsi un acte de dévouement teinté d’élégance si l’on vient soi-même d’une longue journée. La politesse véritable n’est donc pas l’aisance de l’exécution, mais la volonté d’accomplir le geste malgré l’obstacle, témoignant d’une considération sincère pour autrui. Il y a une beauté dans l’effort, un raffinement dans la contrainte acceptée.
La Grâce et l’Esprit : Voltaire et l’Essence de la Politesse
Pourtant, la politesse ne saurait être une affaire austère et grave, dénuée de tout charme. Le rigorisme du jansénisme ne lui sied en rien. Bien au contraire, elle se pare d’élégance et de grâce pour révéler sa véritable nature. C’est M. de Voltaire lui-même, figure emblématique des Lumières, qui sut le mieux en saisir l’essence, parant la politesse de vers immortels. Il affirmait avec un sens aigu de la formule :
« La politesse est à l’esprit Ce que la grâce est au visage. »
Puis, pour amplifier son propos et sublimer le concept, il ajoutait :
« De la bonté du cœur elle est la douce image. »
Ces mots résonnent comme un écho à une certaine vision française du savoir-vivre : la politesse n’est pas une simple façade, un ensemble de règles mécaniques. Elle est l’expression extérieure d’une élégance intérieure, d’une bienveillance fondamentale. Elle donne une forme agréable aux interactions humaines, les rendant plus légères, plus harmonieuses, à l’image des traits délicats d’un visage éclairé par la grâce.
L’Âge d’Or du Salut : Le Tricorne et les Perruques du XVIIIe Siècle
Au XVIIIe siècle, l’aristocratie et la bourgeoisie cultivée avaient élevé le salut au rang d’un art. C’est à cette époque que le tricorne, avec ses trois pointes caractéristiques, régnait en maître. Il rendait le salut d’une élégance et d’une aisance remarquables. La main saisissait naturellement la corne antérieure du chapeau, les doigts se disposant avec une fluidité étudiée. Saluer en ce siècle-là était un plaisir, un geste gracieux qui participait à la chorégraphie sociale.
L’anecdote de la bataille de Fontenoy (1745) est à cet égard éloquente : les officiers, tant français qu’anglais, s’offrirent, avant d’engager le combat à l’épée, des « coups de chapeaux » courtois, témoignant d’une chevalerie qui transcendait les antagonismes. Une image forte, gravée dans la légende, qui illustre la profondeur des codes de l’époque.
Pourtant, l’aisance affichée en ôtant son tricorne n’était qu’apparente. Le véritable défi résidait dans la présence de la perruque ! Ces œuvres d’art capillaires, poudrées avec soin, requéraient des précautions infinies. Quel maladroit oserait la déplacer ? Quel ridicule celui qui l’enlèverait en même temps que son chapeau, risquant de gâcher sa précieuse coiffure ?
Les peintures et gravures des règnes de Louis XV et Louis XVI montrent d’ailleurs fréquemment des gentilshommes de qualité gardant leurs tricornes sous le bras. Ce n’était pas seulement pour offrir la vue de leurs têtes perruquées, mais aussi pour éviter de meurtrir ces perruques si méticuleusement confectionnées.
Ah, ces gentilshommes du XVIIIe siècle ! Maîtres en l’art des « roueries opportunes », ils déjouaient la calvitie et la vieillesse avec une audace charmante. Ils se voulaient grisons dès l’âge de chérubin pour ne jamais vraiment paraître Géronte, leurs cheveux blancs adoptant des boucles éternellement jeunes. Portant sous le bras ce tricorne qui s’y nichait si facilement, nos aïeux multipliaient les révérences et les baisemains, alliant la galanterie à la prestance, dans une danse sociale où chaque geste était calculé pour charmer et impressionner.
L’Ancienneté du Geste : Le Respect par la Tête Découverte
L’habitude de se découvrir devant autrui est loin d’être une invention récente. L’histoire du paysan qui reconnaît le roi Henri IV, à ce que Sa Majesté seule conserve son chapeau sur son chef au milieu de la plus nombreuse compagnie, en est un témoignage éclatant. Ce geste symbolisait la suprématie royale, une marque de respect qu’Henri IV recevait sans avoir à la rendre, soulignant son rang unique. Pourtant, ôter un bonnet de velours, ou même une toque ornée d’une haute plume, n’était pas un acte anodin. Songeons aux précautions qu’un jeune page devait prendre pour ne point abîmer sa coiffe, ni nuire à l’harmonieuse retombée de sa chevelure blonde.

Louis XV âgé de 7 ans et coiffé d’un tricorne, par Justinat (1717)
Au temps de Louis XIII et Louis XIV, le galant cavalier manœuvrait son large feutre empanaché avec l’air du panache qui le caractérisait. Le mouvement par lequel il prenait le bord de son chapeau et le balançait devant une dame était une véritable figure de ballet, décomposée en plusieurs temps, empreinte de théâtralité et de courtoisie. Chaque fibre du vêtement, chaque geste du corps, servait à exprimer le respect et l’admiration.
Contrastes Culturels : De Rome aux Plages Modernes
Il est intéressant de noter que les Grecs et les Romains, contrairement à nos ancêtres gaulois et à nos coutumes modernes, restaient généralement nu-tête. On ne lit pas dans leurs récits de banquets qu’ils ôtaient leurs couronnes de roses pour accueillir leurs convives, fussent-elles des femmes. Un Petronius, arbitre des élégances, n’aurait pas eu l’idée de se découronner de sa guirlande de roses, dont les pétales risquaient de tomber en hommage sur de délicats pieds nus parfumés de verveine. Leurs traditions de politesse prenaient d’autres formes, moins axées sur le couvre-chef.
Aujourd’hui, sans nous draper de fleurs comme les Anciens, nous nous sommes habitués, surtout durant les mois d’été, à déambuler sur les plages, les cheveux au vent, libérés de toute contrainte capillaire. Paul Sentenac voyait dans cette « conquête de liberté » un reflet de notre époque. Qui dirait que cette aisance ne rend pas plus spontanée la pose de nos lèvres sur les mains fines des joueuses de tennis, ou tout autre geste de galanterie ?

Buste d’Aphrodite et peut-être une interprétation en chair du XXIe siècle. Modèle @angie_karantoni. Source @queencalliope
Le Retour à la Grandeur : Canotier et Haut-de-forme
Fort heureusement, certains chapeaux ont su et savent encore se prêter avec magnificence aux protestations de civilité.
Le canotier de paille, chapeau léger et élégant de l’été, ne se porte que quelques mois mais offre une prise facile, une légèreté qui accompagne naturellement un salut joyeux et décontracté.
Le haut-de-forme, le « tube », comme on l’appelait, semble quant à lui favoriser une envergure, une ampleur du coup de chapeau. Le romantisme, qui l’arbora avec tant de panache, détestait les démonstrations étriquées. Alfred de Musset, svelte dans sa redingote bleue ajustée et finement ganté, ne manquait certes pas de dandysme lorsqu’il enlevait son haut-de-forme devant une dame largement enjuponnée. C’était un spectacle en soi, une harmonie de mouvements qui soulignait l’importance de l’interaction.
Paul Sentenac, au début des années 1920, concluait son observation sur une note d’espoir. Le haut-de-forme, quelque peu négligé durant plus d’un lustre, commençait à reparaître dans les théâtres et au pesage des courses hippiques. Pour lui, si son retour pouvait ramener dans nos manières de saluer plus de politesse et de courtoisie, alors qu’il redevienne entièrement à la mode ! C’était un pari sur l’influence de l’objet sur le comportement, une conviction que la forme pouvait inspirer le fond.

Tonton Humanis un artiste qui remet les codes du dandysme et de l’élégance à l’odre du jour avec ses chapeaux
Les Défis des Chapeaux Modernes : Une Politesse en Évolution
Le XXe siècle, et a fortiori le XXIe, a vu l’émergence et la popularisation de couvre-chefs moins formels, posant de nouveaux défis à l’étiquette.
Le béret basque, par exemple, avec sa singularité et sa simplicité, a su conquérir les cœurs au-delà des montagnes. Adopté par de jeunes hommes et femmes élégants en villégiature, il confère une jeunesse certaine au visage. Mais voici l’envers de la médaille : vouloir faire politesse en l’ôtant expose immanquablement un désordre capillaire, une chevelure emmêlée, loin de l’ordonnancement requis par les grands gestes de courtoisie.
La casquette, pratique en voyage ou pour un look décontracté, nous laisse également tout dépeignés une fois retirée, peu propice à un salut gracieux.
Le feutre mou, quant à lui, peut être esthétique ou disgracieux selon la forme de ses ailes et de sa coiffe. Mais sa nature même le rend difficile à saisir sans le bosseler ou le déformer. Un geste brusque le rendrait inélégant, presque maltraité.
Le chapeau melon, plus rigide, se prend plus aisément. Cependant, si l’on a pour habitude de l’enfoncer profondément, jusqu’aux oreilles, il faut parfois réunir les deux mains pour l’arracher de son crâne. Cette manœuvre peu gracieuse, ce « combat » avec son propre chapeau, incite à l’hésitation.
Ces difficultés pratiques ont donné naissance à des compromis. Le plus courant, et hélas le plus désobligeant, est le fameux geste d’élever un simple doigt vers son chapeau. Paul Sentenac, comme Marcel Boulenger, le fustigeait avec virulence. C’est un geste de la dernière impolitesse, dans sa négligence, sa suffisance, voire le ton indifférent ou protecteur qu’il accuse à l’égard de la personne saluée. Il exprime un minimalisme du respect, une politesse de façade, presque à contrecœur.

Casquette la remplaçante moderne des chapeaux d’antan ?
Le Chapeau Féminin : Une Autre Danse des Manières
Il est essentiel de mentionner que l’étiquette du chapeau ne s’appliquait pas de la même manière aux hommes et aux femmes. Si les hommes étaient tenus de l’ôter en signe de respect dans de nombreuses circonstances, les chapeaux féminins obéissaient à des règles différentes. Le chapeau de femme était considéré comme une partie intégrante de la tenue, un ornement, une parure qui ne se retirait généralement pas, même à l’intérieur, sauf dans des contextes très spécifiques comme le théâtre (pour ne pas gêner la vue) ou à table lors d’événements privés.

Chapeau féminin
Cette distinction illustre la complexité et la nature genrée des codes de la politesse. Le chapeau féminin, souvent somptueux, orné de plumes, de fleurs et de voiles, était une déclaration de mode et de statut, mais rarement un outil pour le salut comparable à celui de l’homme. Il contribuait à l’image globale de l’élégance de la femme, sans les contraintes gestuelles imposées à ses homologues masculins.
Les Codes de l’Étiquette du Chapeau Aujourd’hui : Que Reste-t-il ?
Si le haut-de-forme est aujourd’hui relégué aux mariages et aux réceptions très formelles, et le tricorne aux reconstitutions historiques, les principes fondamentaux de l’étiquette autour du couvre-chef persistent, même s’ils sont assouplis et adaptés à notre époque.

Chapeau haut de forme
- À l’intérieur : Pour un homme, en règle générale, le chapeau se retire en entrant dans un lieu fermé (maison, bureau, restaurant, boutique). Garder son chapeau peut être perçu comme un manque de respect ou une familiarité excessive. Les exceptions concernent les lieux de passage rapide (hall d’hôtel), et bien sûr, les couvre-chefs spécifiquement féminins (chapeaux de mode, bibis) qui sont traités comme des accessoires de coiffure et peuvent rester.
- Lieux de culte : Dans les églises ou synagogues, les hommes retirent leur chapeau. Les femmes peuvent le garder (ou doivent le porter dans certaines traditions religieuses).
- Hymnes nationaux & Cérémonies : En présence d’un drapeau, lors d’un hymne national ou d’une cérémonie solennelle comme un enterrement, les hommes retirent leur chapeau en signe de respect.
- Repas : Le chapeau ne se porte jamais à table, quel que soit le genre.
- Le salut : Le coup de chapeau formel est rare, mais un léger retrait ou un geste de la main vers le bord du chapeau peut encore être un signe de reconnaissance et de respect dans certaines rencontres, notamment entre hommes.
- Casquettes et Bérets : Ces couvre-chefs plus informels sont souvent retirés dans les mêmes circonstances que les chapeaux classiques, surtout s’ils masquent le visage ou donnent une allure trop décontractée.

Au-delà du Chapeau : L’Esprit de la Politesse Française
L’histoire du chapeau et des manières est une illustration parfaite de l’évolution du savoir-vivre en France. Notre pays, réputé pour son « art de vivre », a toujours accordé une grande importance à la politesse, non pas comme une contrainte rigide, mais comme un art social, une manière d’embellir les relations humaines.

Apprentissage des bonnes manières
La politesse française, qu’elle concerne le salut du chapeau d’antan ou le simple « bonjour » aujourd’hui, est profondément enracinée dans le respect de l’autre, la discrétion et l’élégance du verbe. Elle se manifeste par :
- Le salut : Un « bonjour » ou « bonsoir » appuyé, un regard direct mais non intrusif, une poignée de main ferme et sincère (sans être écrasante).
- Les marques de respect : L’usage du « vous » et « Monsieur/Madame » avec les personnes que l’on ne connaît pas, les aînés, ou dans un contexte professionnel.
- La discrétion : Éviter de parler trop fort, de monopoliser la conversation, d’étaler sa vie privée.
- La galanterie : Ouvrir une porte, céder le passage, offrir son aide (même si c’est parfois perçu différemment aujourd’hui, l’intention reste).
- L’art de la conversation : Écouter attentivement, participer avec pertinence, éviter les sujets clivants en société.
- Le respect des convenances : Se présenter à l’heure, répondre aux invitations, ne pas abuser de l’hospitalité.
Ces gestes, petits ou grands, sont les fils invisibles qui tissent le tissu social, créant un environnement de respect mutuel et de considération. Ils sont la « douce image de la bonté du cœur » dont parlait Voltaire, une invitation à une vie plus harmonieuse.
Conclusion
Au fil de cette exploration, le chapeau nous a servi de guide, de témoin privilégié d’une histoire des mœurs et des civilités françaises. Des tricornes majestueux aux bérets modernes, chaque couvre-chef a porté en lui les échos de son époque, les règles du jeu social, les aspirations à l’élégance ou à la décontraction.
Ce qui frappe avant tout, c’est que derrière la matière – la feutrine, la paille, le velours – se cachait toujours une intention humaine. Celle de signifier le respect, d’exprimer la courtoisie, de marquer son rang, ou simplement de charmer. Paul Sentenac, avec sa nostalgie d’une politesse plus grandiose, nous rappelait que l’effort dans l’élégance est une vertu.
Marcel Boulenger, avec son personnage moqueur, nous mettait en garde contre une familiarité qui détruit la belle forme du vivre-ensemble. Et Voltaire, éternellement sage, nous exhortait à voir dans la politesse le reflet de l’esprit et la bonté du cœur.
Aujourd’hui, nos chapeaux sont différents, nos gestes sont simplifiés. Mais la substance demeure. La politesse, qu’elle s’exprime par le retrait d’une casquette ou par une formule de salutation sincère, reste le ciment de nos sociétés. Elle est ce choix conscient de rendre la vie plus douce, plus respectueuse, plus belle pour chacun.
Elle n’est pas une contrainte désuète, mais une liberté choisie : celle de donner de la grâce à nos interactions et de la dignité à notre présence au monde. Alors, que nous soyons coiffés d’un chapeau discret ou d’une chevelure au vent, cultivons avec soin cet art précieux du savoir-vivre, héritage de nos ancêtres et gage d’un avenir plus harmonieux.
Sources et liens
Pour approfondir votre lecture et vérifier les informations citées :
- « Monsieur : revue des élégances, des bonnes manières, et de tout ce qui intéresse Monsieur » (1923) :
- Bien que l’accès direct aux archives spécifiques de 1923 puisse être complexe sans abonnement à une base de données, la BNF (Bibliothèque Nationale de France) conserve de nombreuses revues de cette époque. Vous pouvez consulter les archives numérisées via Gallica, leur plateforme dédiée : Recherche Gallica – Monsieur revue des élégances (Vous devrez peut-être affiner la recherche par date).
- Marcel Boulenger (Romancier et Escrimeur) :
- Informations biographiques sur sa carrière olympique et littéraire : Marcel Boulenger – Wikipedia
- Voltaire (François-Marie Arouet) :
- Ses œuvres complètes sont disponibles. Les citations sur la politesse sont tirées de ses poèmes ou correspondances. Une bonne ressource est le Projet Gutenberg ou la BNF : Œuvres de Voltaire – Projet Gutenberg
- Histoire du Tricorne et de la Mode au XVIIIe siècle :
- Le Château de Versailles offre d’excellentes ressources sur la mode de l’époque : Les Costumes à la Cour de Versailles – Château de Versailles
- Le Palais Galliera (Musée de la Mode de Paris) propose également des expositions et des articles sur l’histoire du costume : Palais Galliera – Musée de la Mode de Paris
- Henri IV et l’anecdote du chapeau :
- Cette anecdote fait partie du folklore et des récits historiques populaires sur Henri IV, souvent rapportée dans des ouvrages d’histoire populaire ou des recueils d’anecdotes royales.
- Étiquette moderne du chapeau :
- Des sites spécialisés dans le protocole et le savoir-vivre peuvent offrir des guides pratiques : Savoir-vivre et Etiquette – Marie Claire
- Des blogs et magazines sur la mode et les tendances abordent aussi ces sujets : Vogue France – Etiquette et Mode
Copyright © 2019 Angie Paris Rues Méconnues Officiel. 1997-2019 Tous droits réservés.
#France #BonnesManières #GoodManners
Sur le même sujet
Comment s’habiller comme une Parisienne en automne : Le Guide Ultime




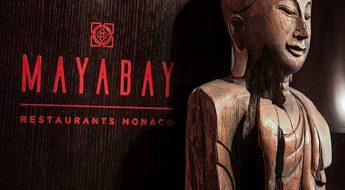




Commentaires récents